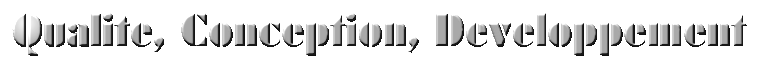
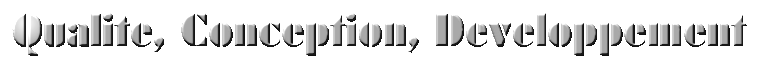 |
|
Natation
IntroductionCe texte n'a pas pour but de décrire en détail les mouvements des quatre nages … Je vais casser pas mal d'idées reçues sur la natation puis je vais dévoiler des aspects méconnus de cette discipline. Je suis absolument certain que vous n'avez jamais entendu un tel discours sur la natation … Cette réflexion est le fruit de 20 ans d'entraînement régulier. J'espère vous donner l'envie de nager.Comparaison natation / activités terrestresLa notion de "poids du corps"Cette notion est pratiquement absente de la natation. Le corps est en apesanteur dans le milieu liquide. Seules deux nages font intervenir la notion de poids du corps, mais de façon indirecte et sans comparaison avec les activités terrestres. Ces deux nages sont la brasse et le papillon (cf note 1). Aussi bien en brasse qu'en papillon, il est nécessaire de soulever la poitrine hors de l'eau pour respirer . Il faut donc utiliser les bras et tout le corps afin de soulever la poitrine hors de l'eau.En natation la notion de " poids du corps " est tout á fait négligeable devant la notion de " résistance du fluide " … Tout l'art de la natation réside dans la maîtrise de la " résistance du fluide ".
Note 1: Il ne faut pas utiliser le cou (en tirant la tête vers
l'arrière) pour respirer ! Cela est nuisible pour l'hydodynamique, et de plus cela
fatigue beaucoup les cervicales. Ce défaut s'observe pratiquement toujours chez les
nageurs débutant.
Dans toutes activités terrestres le déplacement se fait en grande partie grace á la réaction du sol sur la plante des pieds. La masse du corps repose sur les pieds. Les pieds, très sensibles, jouent un grand rôle car ils nous permettent d'estimer l'intensité, le sens et la direction de la réaction du sol.
En natation le déplacement résulte de l'utilisation de toutes les parties du
corps : mains, avant bras, cuisses (penser au ciseaux de la brasse), tibias, dos (penser
á l'ondulation du papillon), … C'est le corps dans sa totalité qui nous
renseigne sur la réaction du fluide. Il peut s'agir de réactions motrices
(pression sur les zones motrices) ou de réactions " résistantes "
(frottement du fluide contre le corps - ralentissement). La perception au niveau des pieds
est tout á fait négligeable.
De par la différence entre la réaction de l'eau et la réaction du sol,
le travail musculaire en milieu aquatique est différent de celui en milieu terrestre.
En milieu terrestre, les muscles doivent répondre de façon tonique (par impulsions).
En milieu aquatique la réponse musculaire est très progressive et se prolonge
pendant tout le mouvement. Par exemple en nage libre il faut appliquer une tension musculaire
progressive sur toute la durée de la poussée (quand le bras est sous l'eau).
Deuxième idée fausse : un bon nageur est quelqu'un de très musclé. C'est totalement faux ! S'il est vrai que les nageurs de compétitions sont, en général bien musclés, c'est parce qu'ils recherchent avant tout la performance. Mais prenez un haltérophile et demandez lui de nager … le résultat risque d'être décevant. Troisème idée fausse : un bon nageur possède une grande souplesse articulaire. C'est faux, on peut nager très bien et ne pas être spécialement souple Il est vrai, qu'en observant un bon nageur, vous avez l'impression qu'il ne déplace " tout en souplesse " … mais cela ne vient pas de la souplesse du nageur lui même. Un contorsionniste n'est pas avantagé face á " monsieur tout le monde " quand il s'agit de nager.
La natation n'est ni une question ne force, ni une question de souplesse. Une personne
" ordinaire ", qui ne " paie pas de mine " peut se révéler un excellent
nageur.
Concrètement, comment cette prise de conscience se matérialise-t-elle dans la pratique? La réponse est simple et tient en trois mots : pression, écoulement et tonicité musculaire.
Remarquer que je n'ai pas prononcé les mots force, style, souplesse ou vitesse. Le style, la " souplesse " du nageur et sa rapidité de déplacement dans l'eau découlent directement de la prise de conscience de la viscosité du milieu aquatique.
Note 2: Cf l'ondulation du papillon.
Remarquer que les différences de pressions á l'origines du déplacement du nageur sont de la même nature que celles á l'origine du vol des oiseaux … L'eau et l'air sont des milieux comparables du point de vue de la mécanique. Le coefficient de viscosité de l'eau est beaucoup plus élevé que celui de l'air, mais ces deux corps obéissent, globalement, aux mêmes lois de la mécanique.
Remarque: Dans des conditions " extrêmes ", ces deux corps ont des
réactions incomparables. Mais ces conditions ne nous intéressent pas : un
nageur ne va pas nager dans une eau á 99,9 ° (juste sous le point d'ébullition)!
La natation est une activité physique … il convient donc d'adopter un discours pratique. Un nageur comprendra tout de suite les termes " écoulement " et " pression " car ce sont deux notions " palpables ". Par contre, il n'est pas évident qu'il saisisse la relation physique (théorique) entre pression et écoulement. L'écoulement de l'eau autour de son corps renseigne le nageur sur l'hydrodynamisme de son corps. Si l'eau s'écoule bien, cela signifie que le corps du nageur offre peu de résistance au déplacement.
En se concentrant en permanence sur la sensation de l'eau qui s'écoule le long de son
corps, le nageur peut modifier la position de tout son corps (bras, jambe, buste et
tête) afin de faciliter cet écoulement. N'avez- vous pas observé les
bons nageurs ? Ils ont tous la même façon de nager … vous ne verrez jamais un bon
nageur lever la tête pour respirer en brasse (or c'est un défaut très
courant). En faisant ainsi vous augmenter la résistance á l'écoulement
de votre corps … en d'autres termes vous n'êtes pas hydrodynamique. Imaginer un peu
que l'on vous attache un seau aux pieds pour vous ralentir. En plus, en levant la tête
pour respirer vous vous faites mal aux cervicales.
Ce sont des constations tout á fait générales. On peut les appliquer á n'importe qu'elle activité physique, et en particulier á la natation.
En nage libre par exemple, lorsque vous sortez un bras de l'eau, vous devez décontracter tous les muscles du bras … Vous êtes gagnant á tous points de vue:
L'exemple le plus flagrant est le papillon. Si vous n'avez pas saisi les cycles contraction / repos en papillon, vous ne pouvez tout simplement pas nager le papillon. C'est le cas extrême. Les débutants sont contractés en permanence lorsqu'ils essayent le papillon … ils ne nagent pas 20 m. Au delá ils sont essoufflés.
Bien pratiquée, la nation vous apporte:
Accessoirement la natation développe aussi votre musculature, mais il n'est pas
nécessaire d'être très musclé pour bien nager. Il faut casser le
cou á la méthode traditionnelle d'enseignement de la natation. Faire des
longueurs dans le seul but de faire des longueurs, est totalement inefficace. Après
de longues années d'entraînement á vous farcir des longueurs, vous
deviendrez peut-être un bon nageur. Mais vous ne saurez pas pourquoi … C'est une
technique de brute qui risque de vous dégoûter de la natation. En plus vous passez
á côté de l'essentiel, quel dommage !
J'ai trouvé sur le net un text très intéressant traitant de la proprioception en milieu aquatique. Ce texte expose de facon très détaillée les idées que j'évoque dans ma réflexion sur la natation. Ce texte provient de l'URL:
Le texte original, au format Word, n'est pas très bien présenté. Aussi je
l'ai converti au format HTML. INTRODUCTIONC’est par le mouvement que l’homme se construit, s’organise de façon cohérente par rapport au monde environnant. Nous entrons en relation avec l’espace selon deux systèmes distincts, celui qui concerne l’espace du corps et celui qui concerne l’espace extra corporel.On distingue des récepteurs à distance: l’oeil, l’oreille externe, mais aussi des récepteurs de contact et de pression. Le contact solide et permanent de la motricité du terrien est assuré par ses appuis plantaires. Il existe un lien indissociable entre l’action, la cognition et la perception dans l’organisation de l’action motrice. La perception est caractérisée par l’implication instantanée de l’activité coordonnée de plusieurs systèmes sensoriels.(NEISSER- p347)(1). Elle n’est pas seulement une interprétation des messages sensoriels, elle est simulation interne de l’action, jugement et prise de décision; elle est anticipation des conséquences de l’action.(7) Un grand nombre de récepteurs sensoriels (extéro et proprioceptif) participent à la proprioception dans son rôle de contrôle de la posture et du mouvement. La particularité du milieu aquatique entraine une modification des sources d’informations propres à l’organisation motrice du terrien remettant en cause ses repères habituels. LES MODIFICATIONS COMPORTEMENTALES IMPOSEES PAR LE MILIEU.L’enjeu pour le futur nageur est de passer d’une motricité à contrôle extéroceptif, à une motricité à contrôle kinesthésique. Il y a alors une remise en cause:
L’ORGANISATION POSTURALE DU TERRIEN ET DU NAGEURl’équilibre vertical et géocentré du terrien est assuré par des automatismes acquis; il est réglé par l’ensemble des sensations qu’il a de son corps. Mais également par des réflexes et en particulier:
L’ensemble de ces informations provenant de l’oeil, du pied, de la nuque et de l’oreille interne, permettent au système postural, soumis à la pesanteur de maintenir en permanence l’équilibre vertical du terrien. Dans l’eau, les informations prélevées par l’ensemble de ces capteurs sont modifiées et rendent le comportement du débutant inadapté au nouveau milieu. En effet, la locomotion aquatique impose:
Les différentes structures nerveuses impliquées dans le mouvement et la postureIl existe 3 types d’afférences sensorielles:
Les afférences extéroceptivesLes récepteurs sont situés à la périphérie de la surface du corps et donnent des informations sur l’environnement
Les afférences proprioceptivesLa kinesthésie est une modalité de la sensibilité proprioceptive. Elle signifie sens de la position, sens du mouvement. Elle permet de discriminer la position des différentes parties du corps, le sens, l’amplitude des mouvements grâce aux récepteurs de la proprioception. Ils rendent compte de la position du corps et des segments par rapport au corps dans l’espace. La kinesthésie ne constitue pas un sens unitaire comme la vision, l’audition; on pense que le cortex utilise une combinaison de signaux émis par l’ensemble des récepteurs; c’est cette combinaison qui est à la source de la kinesthésie. Ils regroupent:
La fonction essentielle du labyrinthe est de stabiliser la position des yeux, de la tête et du tronc par rapport à l’espace. Il régit les réactions commandées par la position de la tête par rapport à la verticale.Il règle de ce fait le tonus des muscles de la nuque car le vestibule est sensible à l’activation des capteurs des muscles du cou..Les réflexes vestibulaires stabilisent l’image sur la rétine quand nous nous déplaçons. Vision et canaux semi-circulaires sont associés dans la perception. Les 3 paires de muscles des yeux sont dans le même plan que les canaux; il y a là une convergence géométrique favorisant la perception et le contrôle du mouvement. La vision est trop lente pour détecter les mouvements rapides (au-delà de 600° par seconde). Les capteurs vestibulaires mesurant vitesse et accélération renseignnent le cerveau sur la mise en mouvement, plus vite que la vision. Le système labyrinthique ou vestibulaire dispose de deux groupes de récepteurs:
L’oreille interne est le détecteur de toutes les variations dynamiques des mouvements. Il détermine la trajectoire et les différentes positions le long de cette trajectoire. Fixer les détecteurs, donc fixer la tête sur la trajectoire est le moyen le plus efficace d’utiliser ce détecteur pour déclencher d’autres mouvements.(4) Pour le débutant, la première source d’accès à l’information étant visuelle, le réflexe occulo-vestibulaire est perturbé dans l’eau et ne permet pas d’utiliser la vision, donc de stabiliser le champ visuel. C’est la raison pour laquelle les informations sensitivo-sensorielles prennent le relai pour construire l’espace d’action. L ‘information visuelle, même modifiée doit demeurer pour perturber le moins possible la stabilité de la tête pour redonner au système vestibulaire sa fonction première. Le débutant a besoin de repères stables pour stabiliser la tête, ce qui permet de déclencher les mouvements prioritaires des bras, source de progrès en natation. Ces repères vont permettre de construire un espace dans lequel la motricité va s’organiser. Ils se situent plus particulièrement autour de la tête et aident à construire les limites de l’action des bras. Du fait de la multiplicité des récepteurs impliqués, la perception de la trajectoire dans le mouvement peut être influencée par la façon dont le mouvement s’est produit; par exemple, recréer un mouvement à sec en natation, modifie les perceptions kinesthésiques, donc, donne une fausse image du bon mouvement. L’approche de type bio-informationnel vient compléter les approches bioméca et bioénergétique de l’activité. Elle permet de mettre en place une démarche d’ exploration et d’appropriation active du milieu. Les progrès ne sont plus conçus à partir de programmes moteurs préétablis ( la répétition ou l’imitation du bon modèle) mais à construire dans un répertoire d’actions très variées. COMPORTEMENT DU NAGEURIl reçoit à chaque instant de ses déplacements des informations sensorielles: déplacement par rapport au fond de la piscine, par rapport à la ligne d’eau, à ses adversaires, etc..; des informations proprioceptives sur les positions successives des segments par rapport au corps, de ses articulations, de son corps lui-même. la situation du nageur, "l’état du système", est caractérisé par ces informations qui remontent au SNC. Les différents états du nageur sont codés et l’exploitation cohérente des informations est permise grâce à 3 niveaux de fonction: l’une concerne l’extraction des informations pertinentes qui arrivent souvent mélangées au cerveau, surtout chez le débutant. Le bruit de l’attaque des bras de l’eau, celui des vagues, la juste appréciation du niveau de la face par rapport à la surface de l’eau, le déplacement rectiligne pour parvenir au mur etc.. A cette étape, le nageur doit séparer les sources d’information.
la seconde fonction est relative au codage et à la représentation du nageur dans le milieu, du milieu lui même. A ce stade, l’information est quantifiée car le milieu étant stable, les situations de déplacement dans l’eau sont souvent identiques pour une même nage ou forme de locomotion. Le troisième stade est celui de l’exploitation des informations codées, pour anticiper ou ajuster la bonne réponse, grâce à l’association d’une suite d’états : le plongeon, les déplacements, le virage.. Ces trois moments, séparation des sources, quantification des données, prédiction ou choix des bonnes réponses, exigent un apprentissage et une mémorisation des différents traitement à effectuer et des décisions à prende. Le nageur expert met au point des stratégies de gestion optimale des informations, à un niveau de conscience faible; car c’est le contrôle automatique de la motricité qui prend le relai nécessitant un faible effort mental. Le débutant a son attention retenue par une quantité de paramètres qu’il tente de contrôler simultanément sans y parvenir, alors que l’expert réduit sa charge attentionnelle et informationnelle aux seuls indices pertinents pour réaliser la tâche; celle-ci est de plus en plus directement contrôlée par l’information proprioceptive. L’expert se dégage des boucles cognitives longues et coûsteuses en temps de traitement; Les contrôles sensorimoteurs caractérisés par leur caractère automatique, ne nécessitent pas la mobilisation de processus attentionnel du sujet (Paillard)(2). Le traitement de la tâche et son contrôle à partir des circuits proprioceptifs est moins coûteuse que par le guidage visuel. NATURE ET ROLE DES DIFFERENTS REPERES EN NATATION POUR PROPOSER DES TACHESL’homme possède et utilise 5 sens. La kinesthésie, le sens du mouvement est le 6ème sens. En natation, les informations de nature extéroceptive et proprioceptive permettent de construire un nouveau référentiel d’action chez le débutant. Mais quel que soit le niveau , elles sont en permanence utilisées par le nageur pour produire, contrôler et assurer une meilleure efficacité de l’action . Les informations extéroceptivesvisuelles: dans l’eau, la vision n’est pas réduite mais modifiée selon D. Chollet (5). Elles jouent un rôle fondamental dans l’équilibration et l’orientation du corps dans le milieu, d’ou l’importance chez le débutant de conserver les yeux ouverts.Par contre la recherche des déplacements yeux fermés peut favoriser la perception plus fine du placement de la tête.La vision facilite le repérage du nageur dans l’espace : lors des départs et des virages , par rapport à la ligne de fond, lors du sauvetage, lors d’une compétition etc...ainsi que la localisation des segments. Il est intéressant de proposer des tâches contrôlées par la vision afin de mieux placer les surfaces propulsives, lorsque celles-ci ne sont pas dans le champ visuel: ex.
La vision périphérique: (récepteurs des cellules en bâtonnets) . Elle a pour rôle de localiser une cible dans le champ visuel dans une situation dynamique; les informations sont rapides mais peu précises.Elle intervient quand il s’agit de se régler par rapport au mur, aux autres etc.. La vision centrale (récepteurs des cellules en cônes). elle intervient prioritairement dans les situations statiques. Elle a pour rôle d’itentifier les informations recueillies; elles sont précises mais lentes à mettre en oeuvre. Elle intervient dans la localisation des segments, le placement des appuis, la tonicité... Auditives: de même , l’audition est modifiée. Elle aide le nageur à percevoir le paramètre rythmique des mouvements; elle permet de vérifier si la main entre dans l’eau sans frapper , de recevoir les consignes verbales. Toutefois, le débutant éprouve un déficit auditif car confronté simultanément aux problèmes respiratoires et de vision; Il faudra donc l’intégrer progressivemement tactiles: les repères tactiles aident à la construction de l’espace; ils délimitent les actions devant et derrière, ce qui à terme permet de construire l’amplitude. Les repères mains devant, cuisses, oreilles, tenue de la planche, port des plaquettes sont une aide:
Ils jouent également un rôle dans la perception temporelle indissociable de l’espace. Les capteurs du toucher ont le pouvoir d’anticipation car ils mesurent les variations rapides des forces de pression ou de la vitesse de glissement d’un objet sur la peau. Ils sont répartis dans les régions les plus impliquées dans la perception tactile (bouche, main, pied, cuisse). Les informations proprioceptivesIssues des récepteurs internes, l’organe de Golgi et le récepteur de Ruffini, elles informent sur la position et les mouvements propres au système et à ses parties. Ils recueillent des sensations renseignant sur la tension musculaire, la position et l’activité des articulations ainsi que de l’équilibre. Elles sont de plus en plus sollicitées au fur et à mesure du niveau d’expertise. Les sensations kinesthésiquesLes capteurs neuro-musculaires détectent l’allongement du muscle; ils permettent de construire l’amplitude.Le cerveau peut modifier leur sensibilité grâce aux motoneuronnes gamma sous le contrôle de la volonté et de l’intention. Il y a là un mécanisme d’anticipation dû à la modulation des propriétées dynamiques des fuseaux musculaires. les récepteurs articulaires renseignent sur la position de l’articulation et la direction du mouvement ; utiles dans la construction des trajets moteurs.Les récepteurs de Golgi mesurent l’effort exercé par le muscle sur son articulation. Situés dans les tendons en série avec le muscle. Ce sont des capteurs de variation de force. le système vestibulaireInopérant chez le débutant qui doit basculer la tête de 90°, il aide à construire les différentes formes d’équilibre dans l’eau . Que le corps soit vertical ou groupé ou allongé, il y a équilibre chaque fois que le centre de gravité passe par la ligne de gravité. Intervenant dans les fonctions d’équilibration statique et dynamique, il aide à percevoir les rotations avant et arrière lors des virages , des départs, des plongeons canards, des accélérations car ils sont sensibles à la vitesse de déplacement. D’autre sources d’informations contribuent à améliorer les repères chez le nageur; L’amplitude et la fréquence gestuelle sont des repères ; le chronomètre également, ainsi que l’allure adoptée par un partenaire. conclusionLa prise d’information est particulière et complexe en natation, du fait de la nature du milieu.Elle intervient dans l’appropriation et la maîtrise simultanées de la respiration, de l’équilibre et de la propulsion.Toute la difficulté pour le débutant est de construire un nouveau référentiel utilisant de nouvelles sources d’informations qui progressivement transformeront les réflexes et les automatismes du terrien. Le passage d’un référentiel visuel à un référentiel majoritairement proprioceptif constitue la différence et l’enjeu entre le débutant et l’expert.dans cette construction, la tête, son placement et son utilisation aura des conséquences sur la prise d’information, l’équilibre, la respiration et la propulsion. Elle demeure donc bien la clé des réorganisations locomotrices. Bibliographie
|
|
|